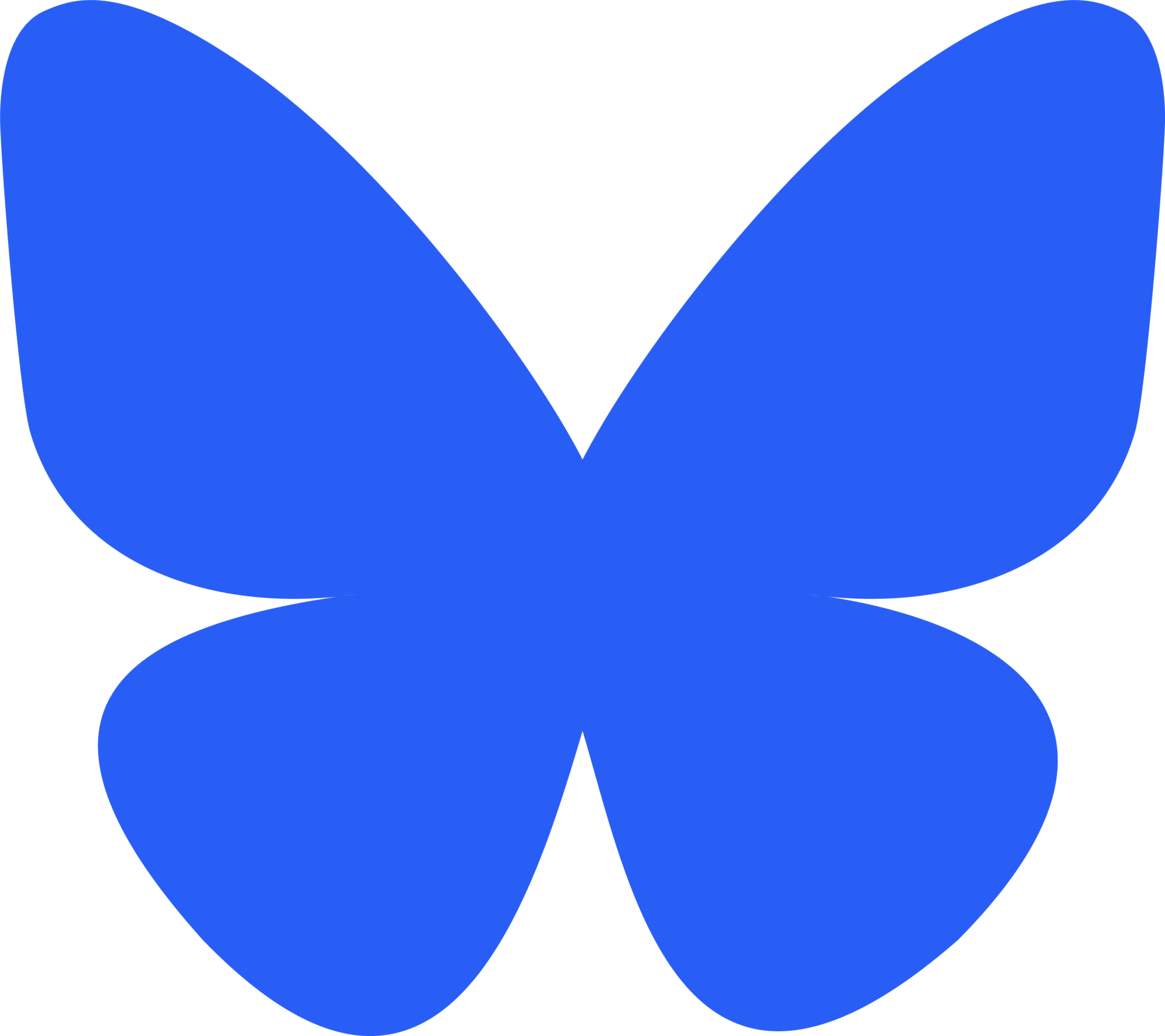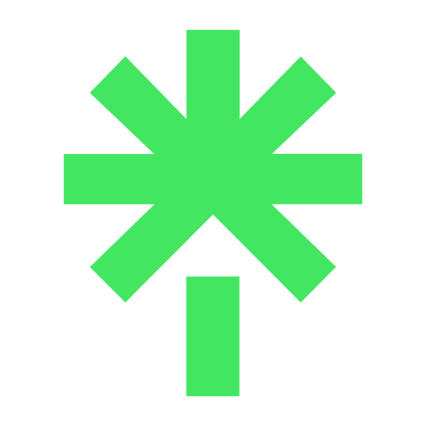Synthèse et podcast de la table-ronde « Numérique et personnes vulnérables »
Table-ronde « Numérique et personnes vulnérables »
Centre Teilhard de Chardin, 27 mars 2025
Intervenants : Charlotte Wendling (Croix-Rouge française), Jean-Marc Potdevin (Entourage), Frère Benoît Dubigeon (aumônier)
Modération : Catherine Larrieu (Centre Teilhard de Chardin)
Première rencontre du cycle « Numérique et vulnérabilités » proposé par le groupe de réflexion « Intelligence artificielle » du Centre Teilhard de Chardin. Pilotes du cycle : Bertrand Thirion (responsable de ce groupe de réflexion), Corinne Bebin, Bruno Dufay, Catherine Larrieu.
Synthèse de la table-ronde
La rencontre inaugurale du cycle de réflexion sur le numérique, organisée par le groupe de réflexion « IA » du Centre Teilhard de Chardin, s’est consacrée à un thème fondamental et souvent négligé : celui du rapport entre le numérique et les personnes vulnérables. Loin des seuls enjeux technologiques ou de l’intelligence artificielle, les intervenants ont choisi d’aborder le numérique dans son usage quotidien, tel qu’il façonne ou fragilise les existences de ceux dont la société ne perçoit pas toujours la parole. L’objectif : réfléchir au potentiel ambivalent des outils numériques pour exclure ou inclure, isoler ou relier, appauvrir ou redonner une voix.
Trois intervenants ont apporté leur éclairage à cette problématique complexe. Charlotte Wendling, en tant que responsable du pôle inclusion numérique de la Croix-Rouge française, a présenté une enquête approfondie sur les usages numériques de personnes en situation de handicap. Jean-Marc Potdevin, fondateur de l’association Entourage, a partagé son expérience d’un réseau social solidaire destiné à lutter contre l’isolement des personnes en grande précarité. Enfin, Frère Benoît Dubigeon, aumônier en milieu carcéral, a offert une méditation spirituelle et existentielle sur la vulnérabilité, nourrie par son engagement auprès des personnes détenues.
Tous trois s’accordent sur un constat essentiel : la vulnérabilité ne saurait être réduite à une déficience ou à une marginalité. Elle est une dimension constitutive de l’humanité. Être vulnérable, c’est être exposé à la blessure, à la dépendance, à l’inattendu. Mais cette fragilité n’est pas un déficit : elle est aussi ouverture à l’autre, à la relation, à une vérité plus profonde sur soi. En ce sens, la technologie, loin d’être neutre, devient un révélateur : elle peut exacerber les failles, mais aussi les panser — selon les logiques qui la sous-tendent et les usages qu’on en fait.
Charlotte Wendling a partagé les fruits d’une immersion dans plusieurs établissements médico-sociaux, menée avec Emmaüs Connect. Loin des caricatures, cette enquête montre la grande hétérogénéité des situations : certaines personnes en situation de handicap sont très autonomes numériquement, quand d’autres peinent à utiliser une souris ou à comprendre une interface. L’usage de YouTube suppose par exemple une compétence en lecture et en saisie d’informations, ce qui représente déjà une barrière importante. D’autres personnes, au contraire, maîtrisent les réseaux sociaux, mais tombent dans des pièges affectifs, comme ces arnaques sentimentales douloureuses.
De ce travail de terrain, quatre grands besoins ont émergé : rendre le numérique plus accessible (interfaces, matériel), le sécuriser face aux risques (cyberharcèlement, escroqueries), en faire un outil d’autonomie (accès à la mobilité, à la culture), et surtout former les aidants — souvent eux-mêmes en situation de fracture numérique. Des initiatives concrètes ont été mises en place, comme des supports en FALC (Facile à lire et à comprendre), et un modèle de pair-aidance numérique où des personnes en situation de handicap deviennent à leur tour formateurs.
Jean-Marc Potdevin, pour sa part, a replacé la question du numérique dans une problématique anthropologique fondamentale : celle de l’isolement social. Pour lui, la première pauvreté n’est pas matérielle, mais relationnelle. C’est le fait d’être seul, oublié, invisible. Or, le numérique, souvent accusé de déshumaniser, peut aussi devenir un catalyseur de lien. À rebours des logiques algorithmiques dominantes qui créent des bulles, son association Entourage a développé une application mobile visant à faire se rencontrer les gens d’un même quartier, qu’ils soient avec ou sans domicile. « Ce qui transforme une vie, ce n’est pas la plateforme, c’est la personne qui tend la main », dit-il. C’est pourquoi l’application elle-même reste un outil, un prétexte à la relation. Même les modules d’intelligence artificielle intégrés dans le parcours professionnel (Entourage Pro) ne visent qu’à renforcer l’accompagnement humain, et non à le remplacer.
Enfin, Frère Benoît a rappelé, avec sobriété et profondeur, que la plus grande vulnérabilité est peut-être celle vécue dans les lieux de privation de liberté. En prison, l’absence de numérique est totale : pas de téléphone, pas d’internet, pas même d’ordinateur. Mais cette dépossession radicale peut devenir le lieu d’une reconstruction. Il cite la figure biblique de Job, assis sur son tas de fumier, comme image de cette nudité existentielle : « On a tout perdu, et pourtant il reste quelque chose. » Ce qui demeure, c’est la relation, la parole, l’écoute. Pour Frère Benoît, il s’agit « d’être une oreille grande ouverte ». Une expérimentation de tablettes numériques a bien été tentée dans un centre de détention, pour l’accès à un journal interne ou à des services utiles, mais un incident de sécurité a conduit à sa suppression. Illustration du fragile équilibre entre ouverture et protection dans ces lieux de grande vulnérabilité.
L’ensemble de la conférence a également mis en lumière plusieurs initiatives de terrain, souvent peu visibles, qui montrent comment le numérique peut, dans certaines conditions, être un véritable levier de lien et de dignité. Ainsi, en EHPAD, l’utilisation de casques de réalité virtuelle a permis de stimuler les capacités sensori-motrices de personnes âgées très dépendantes : une résidente, placée dans un univers aquatique immersif, a spontanément tendu la main vers un poisson virtuel — un geste que ses soignants n’avaient plus observé depuis longtemps. Cette scène, émouvante et emblématique, illustre comment un dispositif numérique, bien pensé et bien encadré, peut contribuer à une réappropriation du corps et du monde.
Dans un autre registre, l’e-sport a été expérimenté comme vecteur intergénérationnel. Des tournois de Wii Bowling ont réuni des personnes âgées et leurs petits-enfants autour d’un même écran, renouant des liens parfois distendus. « Les petits-enfants venaient plus souvent parce que mamie avait une Wii », raconte Charlotte Wendling, soulignant la puissance fédératrice du jeu numérique quand il est mis au service de la relation.
La séance de questions-réponses a prolongé cette dynamique réflexive. Le thème de la confiance y a occupé une place centrale. Le numérique peut-il (re)donner confiance à des personnes blessées, marginalisées, ou en perte de repères ? Pour les intervenants, le numérique peut accompagner, encourager, médiatiser. Mais seule la relation humaine — fidèle, patiente, incarnée — peut vraiment restaurer la confiance. La confiance en soi, en revanche, peut être soutenue par des expériences créatives : ateliers de musique assistée par ordinateur pour des personnes autistes, par exemple.
Un autre sujet récurrent fut celui de la cybersécurité, en particulier pour les aidants professionnels ou familiaux, souvent démunis face aux risques du web. Charlotte Wendling a exposé un modèle de prévention en trois temps : avant (sensibilisation aux mots de passe, aux arnaques), pendant (identifier les signaux d’alerte, réagir), et après (reconstruire la confiance après une expérience négative). Ces formations s’inscrivent dans un effort plus large pour rendre les aidants eux-mêmes acteurs de la transition numérique, et non seulement relais techniques.
Enfin, plusieurs échanges ont insisté sur l’importance de l’accueil humain dans toutes les structures d’inclusion numérique. Les dispositifs comme France Services, présents sur tout le territoire, ne se contentent pas de fournir un accès technique, mais proposent un accompagnement incarné, fondé sur l’écoute, la patience et la pédagogie. Il ne suffit pas d’avoir une borne ou un tutoriel : il faut une présence humaine pour guider, rassurer, dialoguer.
En somme, cette conférence a mis en lumière une conviction profonde partagée par tous les intervenants : le numérique, pour être juste et inclusif, doit rester au service de la relation. Il ne s’agit pas de l’idéaliser ni de le diaboliser, mais de le penser comme un outil ambivalent, à orienter activement vers le bien commun. Cela suppose une conception éthique « by design », une gouvernance partagée avec les premiers concernés, et une vigilance permanente quant à ses effets sociaux, symboliques et existentiels.
C’est cette exigence de lucidité, de créativité et de solidarité qui ressort avec force de la rencontre. Si le numérique peut parfois blesser ou isoler, il peut aussi — entre des mains attentives — guérir, relier, restaurer. Il appartient à la société de faire ce choix, collectivement, avec les plus vulnérables, et non à leur place.
Réalisés par des outils d’Intelligence artificielle à partir de l’enregistrement de la table ronde « Numérique et personnes vulnérables », cet article et ce podcast ont ensuite été ajustés puis validés avec les intervenants.
👉 Pour visionner le replay complet de la conférence, cliquez sur le lien suivant.