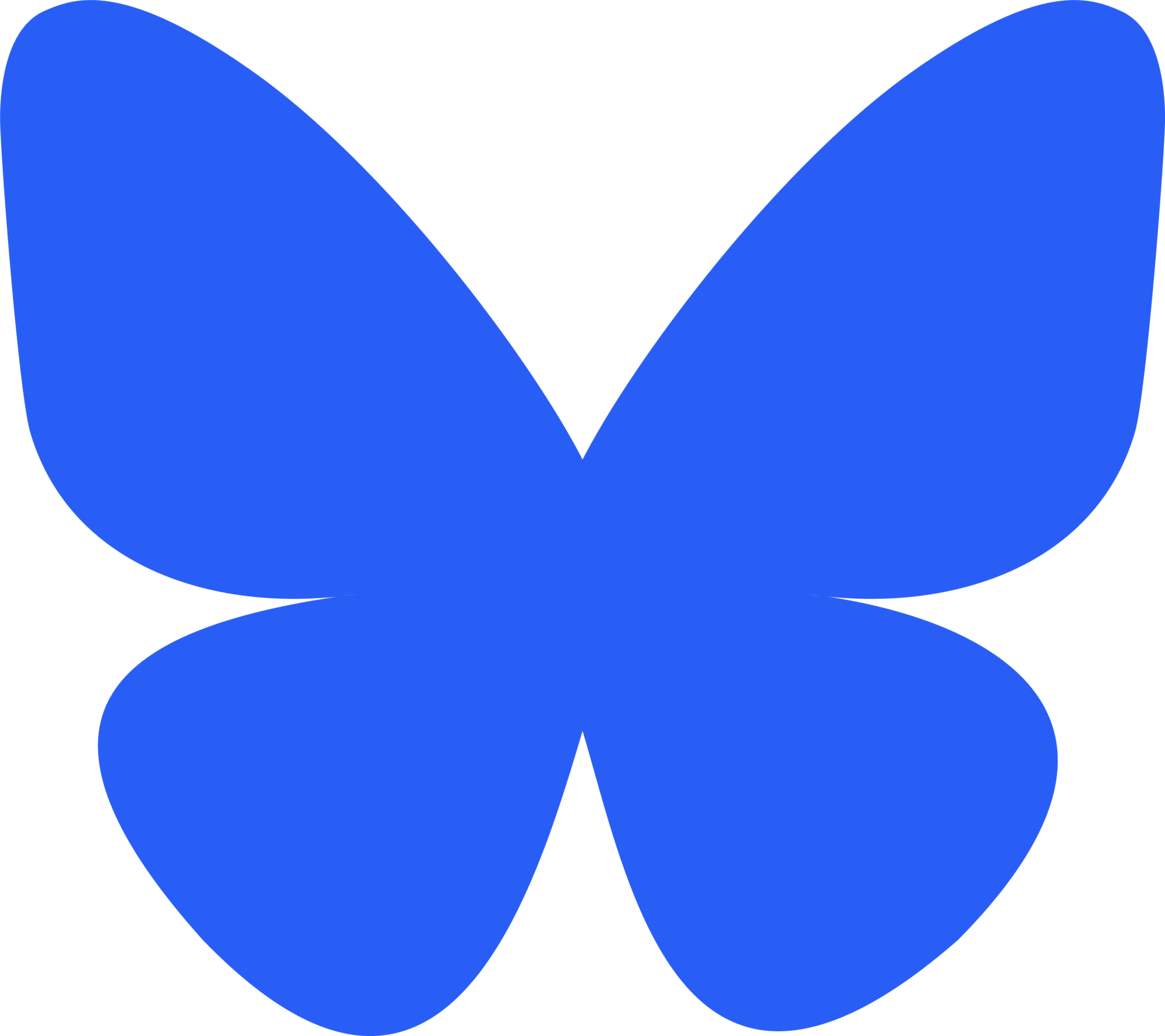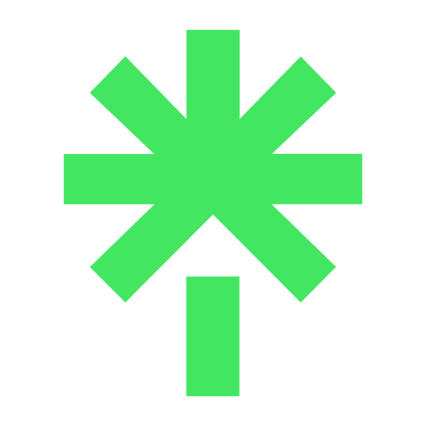Synthèse de la conférence Hindouisme et écologie
Hindouisme et écologie : une relation millénaire
Introduction
La conférence Hindouisme et écologie présentée au Centre Teilhard de Chardin le 11 mars 2025 par Annie Montaut, professeur émérite des Universités et lauréate de deux prix du gouvernement indien, explore les liens profonds entre la tradition hindoue et la pensée écologique. S’appuyant sur son ouvrage Trois mille ans d’écologie indienne (1), l’intervenante analyse comment les principes écologiques sont ancrés dans les textes fondateurs de l’hindouisme et comment ils se manifestent dans les mouvements écologiques contemporains en Inde. Cette présentation part du paradoxe entre une vision de certains mouvements écologiques qui considèrent l’hindouisme comme anti-écologique et une perspective indienne qui y voit les fondements mêmes d’une pensée écologique profonde.
(1) Trois mille ans d’écologie indienne. Penser la nature autrement. Editions du seuil.
Une vision holistique de la nature dans les textes anciens
Le paradoxe des interprétations contradictoires
Annie Montaut commence par présenter un paradoxe fondamental : d’un côté, J.B. Callicott (2), figure de l’écologie profonde californienne, ne comprend pas comment un mouvement écologique aussi puissant que Chipko (3) a pu émerger dans un pays aux traditions philosophiques et religieuses qu’il considère comme anti-écologiques. De l’autre, Vandana Shiva (4), écologiste et féministe indienne, affirme que les fondements mêmes de la pensée indienne sont profondément écologiques.
Pour Vandana Shiva, ces fondements s’inscrivent dans la pensée de l’interdépendance généralisée, dans le partenariat reconnaissant de l’homme et de la nature, dans le partage des dons divins que nous offre la terre, don non « marchandisable ». Cette contradiction initiale pose le cadre de la réflexion qui sera développée tout au long de la conférence.
(2) Philosophe américain, né en 1941, qui dans son livre Genèse, étaye sa thèse centrale à partir de la notion de grand Soi développée par l’écologie profonde et adhère à l’hypothèse Gaïa.
(3) Le mouvement Chipko est au départ un groupe de villageoises de la région du Garhwal (Etat de l’Uttarakhand) en Inde, qui se sont opposées à l’exploitation commerciale de leurs forêts. Le mouvement est surtout connu pour sa tactique consistant à se coller aux arbres, en les entourant de ses bras pour empêcher que l’on ne les coupe ou scie.
(4) Vandana Shiva (née en 1952) est une universitaire indienne, militante écologiste, défenseure de la souveraineté alimentaire, écoféministe et auteure anti-mondialisation.
Les textes védiques et leur vision cosmique
Les textes anciens, particulièrement le corpus védique, révèlent une profonde connexion avec la nature. Annie Montaut cite un hymne à la Terre issu du quatrième Veda, qui présente la Terre comme une « Mère universelle » et une « maîtresse de ce qui fut et sera ». Cet hymne contient notamment une mise en garde écologique surprenante de modernité : « Ce que je creuse de toi, ô terre, puisse cela même repousser promptement, puissé-je ne jamais atteindre des points vitaux, plutôt ton cœur, ô purifiante. »
Cette vision cosmique s’articule autour du concept de Rita, un terme désignant l’ordre cosmique. Annie Montaut explique que ce mot provient d’une racine signifiant « ajuster » ou « articuler », qui a donné dans les langues européennes des mots comme « rite », « rituel », « art » et « artiste ». Le Rita représente l’agencement qui soutient la terre et régule le cosmos par le juste rapport entre les éléments. Plus tard, ce concept est remplacé par celui de Dharma qui, bien que difficile à définir précisément, constitue le devoir fondamental du croyant.
Une éthique du partage
Dès les textes anciens apparaît une éthique du partage dérivée du principe de continuité entre le cosmos, la nourriture et les humains, illustrée dès le Rig Veda : « L’homme sans sagesse reçoit la nourriture vainement pour lui, arrêt de mort, et il ne cultive ni un bienfaiteur ni un ami. Celui qui mange seul encourt seul la faute. »
Cette philosophie est magnifiquement incarnée dans l’histoire du bol magique d’Aputran, un moine bouddhiste si parfait dans sa dévotion qu’il obtient un bol toujours plein de nourriture pour nourrir les démunis. Après de nombreuses tribulations, il se retrouve sur une île déserte avec son bol, mais préfère se laisser mourir de faim plutôt que de manger seul, sans partager.
L’interdépendance comme fondement de l’écologie indienne
Une vision holistique revendiquée
Vandana Shiva revendique une vision holistique plaçant l’humain comme partie interdépendante de tout le vivant, y compris le minéral dénué de souffle. Il s’agit d’un continuum entre humain / non-humain, dedans / dehors, manifeste / non-manifeste, spirituel / matériel. Cette perspective n’implique pas que l’humain soit identique au non-humain, car l’humain seul possède la capacité de dévier du Dharma, c’est-à-dire du devoir moral et religieux, de juger, et parfois de mal juger.
De cette vision découlent des impératifs écologiques importants : nous ne sommes pas extérieurs à la terre, nous lui appartenons et toute violence envers un élément du vivant revient finalement à une violence envers nous-mêmes. Cette violence relève de la même logique d’exploitation extractiviste que celle qu’inflige un petit nombre d’humains puissants et privilégiés à d’autres humains.
Nature et culture : un partenariat plutôt qu’une opposition
Annie Montaut explique que contrairement aux langues occidentales qui opposent « nature » et « culture », les langues indo-aryennes les conçoivent comme un partenariat. En sanskrit, les termes désignant la nature (prakriti) et la culture (sanskriti) sont formés sur la même base verbale signifiant « agir », avec des préfixes différents :
- Prakriti (nature) : avec le préfixe « pra » signifiant « en avant », désigne un agir dynamique, un réservoir d’énergie libre.
- Sanskriti (culture) : avec le préfixe « sam » signifiant « ensemble », désigne l’agir perfectionné, organisé.
Dans cette conception, cultiver la nature est le contraire de l’exploiter ; c’est la choyer, c’est l’entretenir comme on cultive une amitié.
Une vision répandue dans l’iconographie et les arts
Cette vision d’interdépendance se retrouve dans de nombreuses expressions artistiques indiennes :
- L’iconographie populaire des populations tribales (Adivasis) montre systématiquement une intrication de tous les composants du vivant (végétal, animal, humain, divin).
- L’art hindou populaire et l’art musulman présentent des motifs similaires d’interconnexion.
- La théorie des cinq éléments (espace, air, eau, feu, terre) constitutifs de tout l’univers illustre cette vision holistique dans la peinture abstraite contemporaine.
Cette perspective se reflète également dans l’Ayurveda, médecine traditionnelle attentive à l’interaction et à l’équilibre des cinq éléments dans le corps. Le peintre contemporain Raza a fait de ces cinq éléments le sujet principal de ses créations picturales pendant vingt ans, les représentant comme susceptibles de « mille et une combinaisons » mais renvoyant à un principe suprême, le « point focal » où se rejoignent tous les éléments.
Les mouvements écologiques indiens : l’écologie des pauvres
L’héritage de Gandhi
Annie Montaut montre comment les discours sur l’interconnexion et le respect de la nature se retrouvent dans les positions gandhiennes, bien que Gandhi se soit davantage inspiré du Sermon sur la montagne et de Thoreau que de l’hindouisme orthodoxe. Ses héritiers comprennent des figures comme Vandana Shiva, mais aussi des spécialistes moins connus comme Anupam Mishra.
Anupam Mishra et les techniques traditionnelles de l’eau
Anupam Mishra, spécialiste des techniques traditionnelles de gestion de l’eau, a écrit Tradition de l’eau au désert du Thar, un ouvrage qui a connu un succès extraordinaire en Inde. Ce livre, traduit dans toutes les langues locales avant même d’être traduit en anglais, a été conservé dans de nombreux temples villageois et lu chapitre par chapitre lors de veillées collectives avant d’être mis en pratique.
Annie Montaut détaille les ingénieux dispositifs hydrauliques traditionnels documentés par Mishra :
- Systèmes de captage des gouttes d’eau quotidiennes entre une bande de gypse et la couche sableuse
- Puits profonds (jusqu’à 60 mètres) construits avec des matériaux locaux
- Citernes et grands puits à degrés gigantesques pouvant stocker des millions de litres d’eau
- Lacs de retenue comme celui de Jaisalmer, aussi vaste que la ville adjacente
Ces systèmes combinent l’utile et l’esthétique, avec des écoles, pavillons et temples ornant les rives des lacs. Cependant, les artisans détenteurs de ces savoirs traditionnels ont été largement déconsidérés depuis les années 1950-60, perdant leur travail avec l’arrivée de l’eau courante et se retrouvant souvent précarisés comme journaliers dans les banlieues des mégalopoles.
La crise de la biodiversité et le paradoxe du développement
Annie Montaut souligne que l’Inde contient plusieurs hauts lieux de la biodiversité, dont l’Himalaya oriental, les Ghats occidentaux et les îles Andaman et Nicobar. Cette biodiversité s’effondre rapidement, avec des espèces emblématiques comme le tigre du Bengale en voie d’extinction.
Plus inquiétant encore, la connaissance même de cette biodiversité se perd de génération en génération. Dans un village himalayen étudié, seuls les plus de 55 ans connaissent encore une partie de la faune et de la flore sauvages et leurs usages, tandis que les jeunes générations n’en ont pratiquement aucune connaissance.
Les causes de cette perte sont identifiées : déforestation mécanisée, grands barrages et « révolution verte » qui, depuis les années 1960, a privilégié les rendements à court terme via l’utilisation massive d’intrants chimiques. Ces facteurs ont coïncidé avec la fin des « communs » – terres n’appartenant ni à l’État ni aux privés mais gérées par les communautés locales.
Le cas du Pendjab est présenté comme un exemple frappant : fer de lance de la révolution verte dans les années 1960-70, cet État est aujourd’hui entièrement contaminé par les pesticides et engrais, avec des rendements en baisse, des eaux empoisonnées, des sols moribonds, un taux de suicide des paysans record et une espérance de vie en chute de 5 ans (7 ans dans la capitale, Chandigarh).
Les grands mouvements écologiques indiens
Annie Montaut présente plusieurs mouvements écologiques qui ont marqué l’Inde du 20e siècle :
- Le mouvement Chipko (1973-1980) : signifiant « se coller aux arbres », ce mouvement a réussi à protéger la forêt himalayenne contre l’exploitation commerciale. Des femmes se sont attachées aux arbres pour empêcher les forestiers de l’État de les couper pour une entreprise fabriquant des équipements de sport de luxe. Pour ces femmes, les arbres représentaient une ressource essentielle permettant de nourrir le bétail, se chauffer, cuisiner, trouver des herbes médicinales et fabriquer des outils agricoles.
- Le mouvement pour sauver les Ghats occidentaux : utilisant des stratégies gandhiennes comme les marches de protestation à pied et le jeûne.
- Le mouvement Narmada Bachao : luttant contre les barrages sur la rivière Narmada, ce mouvement n’est pas encore terminé mais n’est pas en voie de gagner.
- Le mouvement Jungle Bachao : le seul à avoir échoué, ce mouvement des populations tribales s’opposait aux plantations de teck qui privaient ces peuples de leur nourriture forestière.
Annie Montaut souligne que ces mouvements correspondent à ce que l’économiste Joan Martinez-Alier appelle « l’écologie des pauvres » (ecology of the poor), ou en Inde « grassroot ecology » – une écologie spontanée venant d’en bas. Ces mouvements ont eu un impact réel à la fin du 20e siècle, mais leur influence semble diminuer aujourd’hui. L’intervenante les oppose à « l’écologie de la sanctuarisation de la nature dans des parcs que visite la bourgeoisie urbaine ».
La persistance des traditions et les défis contemporains
Le renouveau par le travail communautaire
Annie Montaut évoque la renaissance de pratiques traditionnelles de gestion des ressources naturelles, notamment grâce au travail communautaire. Elle cite Gandhi qui, dès 1925, expliquait que ce n’est « pas par magie ni par dévotion qu’on va faire venir la pluie mais par le travail physique, en construisant ce qu’il faut, en plantant. »
Elle présente l’exemple de villages du Rajasthan où, sous l’impulsion de jeunes charismatiques, une association nommée Tarun Bharat Sangh a décidé de « rendre la vie » à un millier de villages (environ 700 000 habitants) régulièrement affectés par la sécheresse et la désertification. Le « Miracle Water Village » au Maharashtra est un autre exemple médiatisé de revitalisation d’un village par la gestion de l’eau, qui a entraîné des améliorations dans tous les domaines (nutrition, éducation, électricité, sanitaires, soins).
Les contradictions du développement urbain
Annie Montaut oppose ces initiatives rurales à certaines formes d’écologie urbaine qu’elle juge superficielles, comme les espaces verts de la Trans-Yamuna à Delhi, construits après l’expropriation de dizaines de milliers de personnes pour faire place à des autoroutes et des aménagements ornementaux.
Elle conclut en soulignant que ce n’est pas un plaidoyer mais « une reconnaissance d’un certain type d’écologie marquante en Inde qui correspond à celle que, pour l’Amérique latine, on a nommé l’écologie des pauvres. »
Les questions-réponses : approfondissements et perspectives
L’ampleur des mouvements écologiques
Interrogée sur l’ampleur de ces mouvements écologiques par rapport à l’immense population indienne, Annie Montaut reconnaît qu’ils ne concernent qu’une fraction de la population. Les populations tribales représentent moins de 9% de la population indienne. Quant aux mouvements comme celui de l’Himalaya ou des Ghats occidentaux, ils ont impliqué une partie considérable mais pas majoritaire de la population locale. Elle compare ces mouvements à la marche du sel de Gandhi qui, quantifiée en pourcentage de la population, ne paraîtrait pas non plus massive, tout en ayant eu un impact historique considérable.
La place de l’hindouisme dans ces mouvements
À la question sur l’inspiration religieuse de ces mouvements, Annie Montaut répond qu’elle varie considérablement. Dans le mouvement Chipko, la dimension hindoue est très présente, avec le respect de la terre, des dieux et les personnes charismatiques de Bahugunal (gandhien, théoricien, traditionaliste) et de Chandi Prasad Bhatt (gandhien pratique « reconstructeur »). Cependant, des communistes se sont également joints au mouvement. Quant aux populations tribales, l’hindouisme y joue un rôle mineur, mais leurs propres cosmogénèses présentent des similarités avec la vision d’interconnexion décrite dans les textes hindous.
Témoignages des participants indiens
Plusieurs participants indiens enrichissent la discussion :
Navnish Ramessur, architecte urbaniste, souligne que la présentation mêlait plusieurs pensées et sujets, relevant davantage de l’Inde et de l’écologie que de l’hindouisme spécifiquement. Il regrette l’absence de mention du Manar Chastre et du Vast Chastre, textes anciens contenant des préconisations architecturales écologiques (plantation d’arbres, infiltration de l’eau) dès le 5e siècle.
Shailendra Mudgal, consultant en environnement depuis 25 ans, explique comment son héritage brahmane l’a inconsciemment dirigé vers l’écologie. Élevé dans la tradition ayurvédique, il témoigne des pratiques écologiques quotidiennes de son enfance : interdiction de jeter quoi que ce soit, choix d’achats écologiques, absence de gaspillage alimentaire, et recyclage systématique. Il mentionne l’existence de programmes universitaires, comme celui de Yale, sur les religions et l’écologie, qui analysent comment les aspects écologiques sont intégrés dans les pratiques religieuses.
Vibhin ajoute une perspective philosophique, évoquant la contribution de Shankara et son système de non-dualité qui questionne l’égocentrisme humain et crée « un pont vers la nature ».
Questions sur la situation contemporaine
Plusieurs questions concernent la situation actuelle en Inde :
- Le mouvement « Natural Farming » : Annie Montaut évoque ce mouvement centré sur la vache sacrée, particulièrement développé en Andhra Pradesh sous l’impulsion de l’État. Le « Zero Budget Natural Farming » utilise les bouses et l’urine de vache comme intrants naturels pour remplacer les produits chimiques. Environ 10% de la population agricole de l’Andhra Pradesh participe à ce programme, mis en œuvre à grande échelle depuis 2019.
- La conciliation entre modernisation et écologie : Concernant les efforts de l’Inde dans l’intelligence artificielle et le développement technologique face aux dégâts écologiques, Annie Montaut confirme l’existence de réflexions sur un mode de développement écologique, dont le programme en Andhra Pradesh est un exemple. Elle souligne cependant que le problème central reste l’accroissement des inégalités.
- Le recyclage et le plastique : Shailendra Mudgal précise que la situation n’est pas homogène en Inde. La première ville au monde à avoir interdit le plastique était indienne, de même que la première région sans plastique. Cependant, à l’échelle nationale, la mise en œuvre des politiques environnementales varie considérablement selon les États et l’engagement des autorités.
- L’influence de la politique sur l’écologie : Annie Montaut s’interroge sur l’impact du virage de l’État indien vers un hindouisme plus affirmé sous le gouvernement actuel. Elle se demande si l’Inde contemporaine, encouragée par cette culture d’État, est réellement plus écologique que l’Inde antérieure, et exprime ses doutes à ce sujet.
Conclusion
La conférence d’Annie Montaut démontre comment les principes écologiques sont profondément ancrés dans la tradition hindoue, à travers ses textes fondateurs qui prônent une vision holistique de la nature et une éthique du partage. Ces principes ont nourri d’importants mouvements écologiques indiens au 20e siècle, particulièrement une « écologie des pauvres » émergeant des besoins fondamentaux des populations rurales et tribales.
Cependant, l’Inde contemporaine fait face à des contradictions majeures entre son héritage écologique et ses aspirations au développement économique et technologique. La perte de biodiversité, la pollution et la dégradation des sols causées par la « révolution verte » illustrent les conséquences d’un modèle de développement qui s’éloigne des principes traditionnels.
Les témoignages des participants indiens enrichissent cette analyse en soulignant la diversité des approches écologiques en Inde et la persistance de pratiques traditionnelles dans la vie quotidienne de nombreux Indiens, malgré les pressions de la modernisation. Ils révèlent également la complexité des enjeux contemporains, où les considérations politiques, sociologiques et religieuses s’entrecroisent pour former un tableau contrasté de l’écologie indienne d’aujourd’hui.
La conférence s’achève sur une note d’espoir prudent, avec la mention d’initiatives locales de revitalisation écologique qui puisent dans les savoirs traditionnels tout en répondant aux défis contemporains. Ces initiatives témoignent de la résilience d’une vision écologique millénaire qui continue d’inspirer des actions concrètes dans l’Inde du 21e siècle.
Cet article a été réalisé par des outils d’Intelligence artificielle à partir de l’enregistrement de la conférence « Hindouisme et écologie » puis validé avec l’intervenante Annie Montaut.